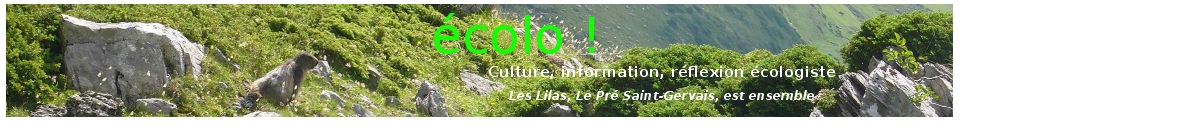par Joël Cossardeaux, pour Les Echos, http://www.lesechos.fr/journal20151002/lec1_enquete/021338331651-les-impacts-ravageurs-dun-rechauffement-de-plus-4-degres-1161405.php La COP21 veut limiter le réchauffement à plus 2 degrés d'ici à 2100. Et si c'était le double ? Malnutrition, disparition des forêts… les conséquences seraient dramatiques pour les pays du Sud.
La COP21 veut limiter le réchauffement à plus 2 degrés d'ici à 2100. Et si c'était le double ? Malnutrition, disparition des forêts… les conséquences seraient dramatiques pour les pays du Sud.
Cela a commencé en 1990 par 3 degrés Celsius de plus qu'avant l'ère industrielle, puis 3,6 degrés en 2001, avant de passer à 4 degrés en 2007 et 4,8 à la fin de l'an dernier. Les projections les plus pessimistes que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a dressé au fil de ses rapports, n'ont cessé d'être revues à la hausse. C'est dire à quel point le réchauffement se fait plus palpable. Voilà pourquoi le sommet de la COP 21, à Paris, vise à obtenir des engagements des Etats suffisants pour limiter le réchauffement à plus 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Pour l'heure, on est loin du compte puisque selon un rapport d'experts paru jeudi, les actions envisagées conduira ient à une hausse de 2,7 degrés.
Que se passerait-il concrètement si le scénario du pire (+4 degrés) se vérifiait ? La réponse est simple : la planète changerait complètement de visage en 2100. Les Pyrénées perdraient leurs glaciers et la plupart des gestionnaires de station de sports d'hiver fermeraient boutique, tandis qu'il ferait bon cultiver la vigne en Scandinavie. Ces conséquences pourraient presque passer pour bénignes au regard de « la probabilité d'impacts graves, étendus et irréversibles » qui s'accroît selon le GIEC. Surtout quand on sait que ce sont les pays du Sud, dont les moyens manquent pour s'adapter, qui vont subir les plus grands bouleversements provoqués par la montée du mercure.
L'agriculture, et en particulier la leur, va souffrir. Les terres arables pourraient sensiblement diminuer en Afrique, en Amérique latine, en Inde et dans le sud de l'Asie où la Banque mondiale chiffre à 10,7 % la part des surfaces cultivables qui pourraient y disparaître. Ce n'est vraiment pas le moment. Les Etats de ces régions vont compter de plus en plus de bouches à nourrir et le pic de croissance de la population mondiale, qu'elles tirent, ne sera en vue qu'en 2100 avec 11 milliards d'individus. D'ici là, les sécheresses et les submersions vont encore s'accélérer, mettant à mal le rendement de nombreuses cultures. La production de blé pourrait chuter de 14 à 25 % d'ici à 2050, celle de maïs et de soja respectivement d'au moins 19 et 15 %.
La planète aura également plus soif. Entre 43 et 50 % de la population mondiale, contre 28 % actuellement, habitera un pays en manque d'eau. L'Afrique, le Moyen-Orient, le pourtour méditerranéen seront les plus touchés par ce qui constitue une menace sur leur sécurité alimentaire. Les pays les plus au nord seront plus arrosés et n'auront pas à faire face à ce problème. Moins peuplés et dotés des bonnes technologies pour gérer la ressource, le réchauffement aura chez eux un impact plutôt positif. Cette carence en eau va aussi peser sur la sécurité énergétique des pays. Les barrages seront plus difficiles à remplir et les centrales plus compliquées à refroidir. Le débit du Danube, du Mississippi et de l'Amazone baisserait de 20 à 40 % avec « seulement » deux degrés de plus à la fin du siècle
Des déserts marins
Mais c'est aussi un appauvrissement considérable de la biodiversité qui est annoncé. Une élévation de la température de 2 à 3 degrés mettrait en jeu la survie de 20 à 30 % des espèces animales et végétales. La forêt en Amazonie, où le nombre d'incendies pourrait doubler d'ici à 2050, sera frappée de sécheresse. Elle pourrait même disparaître en Indochine, elle et ses espèces endémiques. Cette amputation du patrimoine naturel n'épargnera par les océans, dont le niveau s'élèvera de plus d'un mètre en 2100. Dans un scénario à +4 degrés, l'acidité de leurs eaux bondirait de 150 %, celles-ci ne pouvant plus absorber les rejets de CO2. Une catastrophe pour la faune marine et ses zones de reproduction, au premier rang desquelles les récifs coraliens. Et, au minimum, une perte de rendement importante pour les activités de pêche, notamment de coquillages et de crustacés. D'autres espèces, à l'inverse, vont se propager comme les insectes ravageurs.
En France, la chenille processionnaire du pin, un parasite d'origine méditerranéenne déclencheur d'allergies, est aux portes de Paris. Un problème sanitaire qui s'ajoute à bien d'autres, comme la recrudescence les maladies liées à la malnutrition dans les pays du Sud ou la hausse de la mortalité due aux canicules en Europe. De plus en plus soutenues, ces vagues de chaleur pourraient entraîner le décès de 60.000 à 160.000 personnes par an à partir des années 2080.