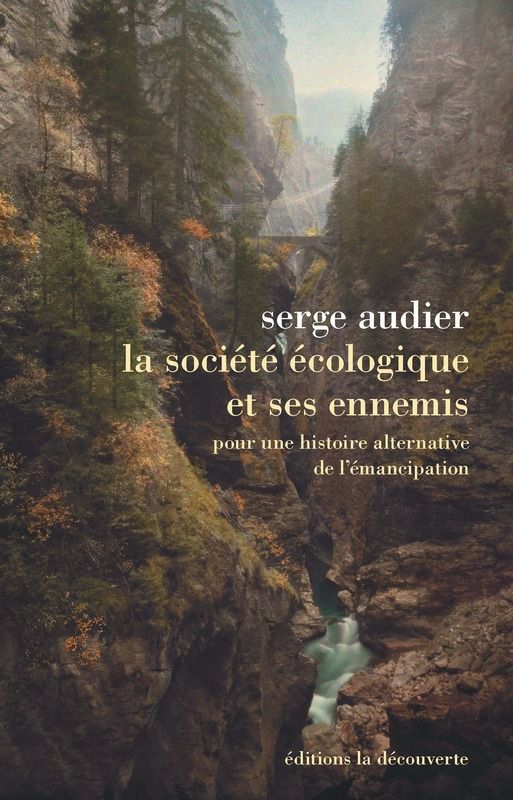Au cours des années 1980 et 1990, l’idée qu’il n’existait aucune solution de rechange aux démocraties de marché a entraîné une forme de fatalisme. A contrario, le réarmement contestataire observable depuis deux décennies replace sur le devant de la scène les affrontements idéologiques. Au point, parfois, d’attribuer à la bataille des idées un rôle et un pouvoir qu’elle ne possède pas. Par Razmig Keucheyan pour Le Monde Diplomatique de mars 2018. En novembre 2015, Razmig Keucheyan était venu aux Lilas , pour nous parler de son travail, cf. La nature est un champ de bataille, Quand la finance se branche sur la nature, et son livre La nature est un champ de bataille ; Lire aussi du même auteur Ce dont nous avons (vraiment) besoin.
C’est Mme Najat Vallaud-Belkacem qui, après tant d’autres, le répète dans un article paru en janvier 2018 : le Parti socialiste (PS) a perdu la « bataille culturelle » — l’expression apparaît trois fois (1). Lorsque M. François Hollande a remporté l’élection présidentielle de 2012, le PS détenait pourtant tous les leviers du pouvoir : l’Élysée, Matignon, l’Assemblée nationale, mais aussi le Sénat et vingt et une régions sur vingt-deux. Rien ne semblait empêcher la mise en œuvre de la politique de gauche que Mme Vallaud-Belkacem, au gouvernement pendant toute la durée du quinquennat, appelle rétrospectivement de ses vœux. Mais les vents contraires soufflaient apparemment trop fort. La « bataille culturelle », ce mystérieux génie qui bride l’ardeur des gouvernements de gauche successifs, était perdue.
Au sein de la gauche — toutes sensibilités confondues — circulent à l’heure actuelle des notions qui paraissent politiquement pertinentes, mais qui s’avèrent dangereuses. L’une d’elles est l’argument des 99 % (2). S’appuyant sur des statistiques établies par les économistes Emmanuel Saez et Thomas Piketty, le mouvement Occupy Wall Street a avancé en 2011 l’idée que l’humanité se divise en deux groupes : l’un, les 1 % les plus riches, capte l’essentiel des bénéfices de la croissance ; l’autre, les 99 % restants, pâtit d’inégalités toujours plus vertigineuses. L’argument s’est révélé efficace pour un temps, suscitant des mobilisations dans divers pays. Mais le problème est vite apparu : les 99 % forment un ensemble extrêmement disparate. Cette catégorie inclut aussi bien les habitants des bidonvilles de Delhi ou de Rio que les prospères résidents de Neuilly-sur-Seine ou de Manhattan qui ne sont juste pas assez riches pour intégrer les 1 %. Difficile d’imaginer que les intérêts de ces populations convergent ou que celles-ci constituent un jour un groupe politique cohérent.
L’argument de la « bataille culturelle » souffre d’une malfaçon analogue. Il n’est pas à proprement parler faux, mais il débouche sur une stratégie politique problématique. On le rencontre souvent à gauche, du PS à La France insoumise, mais également à droite, notamment dans les courants qui se réclament de l’héritage de la « nouvelle droite ». Il découle d’une lecture hâtive d’Antonio Gramsci et de son concept d’hégémonie. L’idée est simple : la politique repose en dernière instance sur la culture. Mettre en œuvre une politique suppose au préalable que le vocabulaire et la « vision du monde » sur lesquels elle repose se soient imposés au plus grand nombre. Si les gouvernements n’appliquent pas leur programme, ce n’est pas qu’ils manquent de courage et d’ambition, ni qu’ils refusent de défendre les intérêts de ceux qui les ont élus : c’est que le « fond de l’air » politique s’oppose à son application. Il faudrait donc modifier l’atmosphère afin de rendre la politique en question concevable.
À l’ère de Facebook et de Twitter, on comprend l’attrait de cet argument. En y souscrivant, on peut faire de la politique confortablement installé chez soi, devant son écran d’ordinateur. Laisser un commentaire sur un site ou écrire un tweet rageur deviennent des actes politiques par excellence. Tout comme publier des pétitions ou des tribunes vengeresses dans les colonnes de quotidiens à l’audience déclinante en caressant l’espoir que ces textes fassent le « tour du Net ».
La « bataille culturelle » a bien entendu son importance. La Chine, par exemple, prend aujourd’hui très au sérieux son soft power. Il s’agit là d’un concept élaboré par le politiste américain Joseph Nye, qui a conseillé plusieurs administrations démocrates depuis M. Jimmy Carter. Selon Nye, au XXIe siècle, le pouvoir d’un pays se mesure moins à son hard power, c’est-à-dire sa puissance militaire, qu’à sa capacité à influencer la sphère publique mondiale en donnant une image positive de lui-même.
Le gouvernement chinois organise ainsi l’activité de netizens (contraction de net et citizens), des citoyens intervenant sur Internet pour défendre les intérêts de leur pays (3). Comme l’a suggéré le président Xi Jinping lors d’un discours au XIXe Congrès du Parti communiste chinois, en octobre 2017, il s’agit de « bien raconter le récit de la Chine et de construire son soft power » en diffusant sur le Net une « énergie positive ». Certes, mais voilà : derrière les bataillons de netizens chinois se trouve l’une des grandes puissances mondiales. Son rang dans les relations internationales, la Chine ne l’occupe pas d’abord grâce à son soft power ou à une quelconque « bataille culturelle », mais grâce à sa puissance économique, que ses dirigeants s’emploient à transformer en puissance militaire.
L’expression « bataille culturelle » doit une partie de son succès à l’hypothèse selon laquelle, au cours des dernières décennies, la droite aurait imposé ses idées, donnant naissance au mélange de néolibéralisme économique et de conservatisme moral dans lequel nous baignons désormais.
Mais, d’abord, la droite n’a pas vraiment eu à gagner la « bataille culturelle », dans la mesure où ses catégories fondatrices, comme la propriété privée des moyens de production ou l’économie de marché, n’ont plus été fondamentalement contestées depuis le milieu des années 1970. Même l’impression que l’après-Mai 68 constitua un âge d’or pour la gauche, voire que ses idées y étaient hégémoniques, tient en partie de l’illusion rétrospective : en France, la droite a occupé le pouvoir sans discontinuer pendant toute cette période. Les politiques redistributives et de reconnaissance des droits des femmes qu’elle concéda furent mises en œuvre moins à l’issue d’une « bataille d’idées » que sous la pression du bloc de l’Est et de puissants mouvements sociaux.
Il n’est même pas dit que le racisme, dont on présente parfois la recrudescence comme le symptôme d’une « droitisation » de la société actuelle, se soit aggravé, bien qu’il ait changé de forme. La société française des années 1960 et 1970 n’était certainement pas moins raciste que l’actuelle (4). Depuis les années 1970, le capitalisme a subi de profondes transformations : financiarisation, effondrement du bloc de l’Est et intégration de cette région dans l’économie mondiale, tournant capitaliste de la Chine, désindustrialisation, crise du mouvement ouvrier, construction néolibérale de l’Europe… Dans ce contexte de crise et de restructuration du système, la droite se tenait prête à saisir des occasions. Elle ne s’en est pas privée, poussant dans le débat public des idées cohérentes dans le domaine politique et économique. Mais la nouvelle hégémonie néolibérale n’a pu émerger qu’à la suite des bouleversements structurels qui avaient objectivement affaibli les forces du progrès. S’imaginer qu’il suffirait de remporter la « bataille des idées » pour que le système change, c’est s’exposer à des désillusions.
L’argument des 99 % et celui de la « bataille culturelle » relèvent d’une même conception du monde social. Celle qui considère la société comme une entité indifférenciée, comme un espace fluide que l’on pourrait influencer dans un sens ou un autre en mettant en circulation des discours. Les théories d’Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe, sources d’inspiration de Podemos (5) et de La France insoumise, sont exemplaires de cette conception.
Des proches du mouvement dirigé par M. Jean-Luc Mélenchon ont créé au début de l’année une chaîne de télévision en ligne baptisée Le Média et lancé une école de formation. Aux dires de leurs animateurs, ces dispositifs visent à mener la « bataille culturelle », à préparer le terrain pour d’autres politiques (6). Ce faisant, La France insoumise s’inspire, en les actualisant, d’institutions sociales-démocrates et communistes : le journal ouvrier et l’école de cadres. Ceux-ci permettaient la diffusion chez les militants et au sein de leur base sociale d’une vision du monde cohérente.
Il manque pourtant un élément essentiel : quelles classes sociales ou coalitions de classes seront les vecteurs du changement ? À qui s’adressent prioritairement Le Média et l’école de formation ? Les communistes avaient pour base la classe ouvrière et les classes alliées, paysannerie et fractions dominées des classes moyennes notamment. Le « bloc social » concerné par le journal ouvrier et l’école de cadres était celui-ci. Mais dans le cas de La France insoumise ? Une « vision du monde » ne devient politiquement efficace que si elle est celle d’une coalition de classes qui s’oppose à d’autres classes. Reste donc à imaginer les contours d’un bloc social à venir.
Contrairement à ce que certains interprètes lui font dire, Gramsci n’a jamais voulu faire de la « bataille culturelle » le cœur de la lutte des classes. Évoquant l’évolution du marxisme de son temps, il affirme que « la phase la plus récente de son développement consiste justement dans la revendication du moment de l’hégémonie comme élément essentiel de sa conception de l’État et dans la “valorisation” du fait culturel, de l’activité culturelle, de la nécessité d’un front culturel à côté des fronts purement économique et politique (7) ». Articuler un « front culturel » avec les fronts économique et politique existants : c’est là sa grande idée.
Cela ne suppose en aucun cas une prééminence du « front culturel » sur les autres. Ni que ce front devienne la chasse gardée de militants opérant dans la sphère des idées. Pour Gramsci, le syndicaliste se trouve souvent en première ligne sur le « front culturel ». Par les luttes qu’il organise, il fait évoluer les rapports de forces et laisse entrevoir ainsi la possibilité d’un autre monde. Ce que Gramsci appelle « culture » diffère très sensiblement de ce que nous entendons couramment par ce terme. La notion d’« hégémonie culturelle » ne désigne pas la péroraison incessante d’intellectuels ou de dirigeants contestataires dans les médias dominants, mais la capacité d’un parti à forger et à diriger un bloc social élargi en éveillant la conscience de classe. Les exemples ne manquent pas, ni à son époque ni aujourd’hui.
En décembre 2017, des salariés de l’entreprise de nettoyage Onet, en région parisienne, ont remporté une victoire importante (8). Ces sous-traitants de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) chargés de la propreté des gares revendiquaient un rattachement à la convention collective de la manutention ferroviaire de la SNCF, le retrait d’une clause de mobilité qui les obligeait à effectuer de longs déplacements, l’augmentation de la prime de panier (indemnité repas) et la régularisation de collègues sans papiers. Au terme d’une grève de quarante-cinq jours, ils ont obtenu satisfaction sur l’essentiel. Pareille lutte s’annonçait d’autant plus improbable qu’elle était menée par des immigrés récents, au sein d’une entreprise sous-traitante et dans un secteur où l’interruption du travail n’a pas un impact vital sur le cours de la vie sociale. Bloquer une raffinerie, c’est bloquer le pays. Mais cesser de nettoyer une gare périphérique en Seine-Saint-Denis… ?
Et pourtant, à force de persévérance, les grévistes et leurs délégués syndicaux ont gagné. Les transformations structurelles du capitalisme depuis les années 1970 ont changé la classe ouvrière. Celle-ci n’a certes pas disparu ; elle est devenue plus diverse socialement, ethniquement et spatialement. Livrer la « bataille des idées » consiste à politiser ces nouvelles classes populaires, au moyen de luttes analogues à celle menée par les salariés d’Onet. Leur victoire montre que l’improbable n’en reste pas moins possible. Le « front culturel », articulé aux fronts économique et politique, c’est exactement cela. Ils ne le savent peut-être pas, mais les grévistes d’Onet sont les véritables héritiers de Gramsci.
Razmig Keucheyan, Professeur de sociologie à l’université de Bordeaux.
(1) Najat Vallaud-Belkacem, « Éloge de l’imperfection en politique », Le Nouveau Magazine littéraire, Paris, janvier 2018.
(2) Lire Serge Halimi, « Le leurre des 99 % », Le Monde diplomatique, août 2017.
(3) Cf. Yuan Yang, « China’s Communist Party raises army of nationalist trolls », Financial Times, Londres, 29 décembre 2017.
(4) Cf. par exemple Yvan Gastaut, « La flambée raciste de 1973 en France », Revue européenne des migrations internationales, vol. 9, no 2, Poitiers, 1993. Lire également Benoît Bréville, « Intégration, la grande obsession », Le Monde diplomatique, février 2018.
(5) Lire Razmig Keucheyan et Renaud Lambert, « Ernesto Laclau, inspirateur de Podemos », Le Monde diplomatique, septembre 2015.
(6) Cf. Laure Beaudonnet, « Aude Lancelin, auteure de “La Pensée en otage” : “Tout le circuit de l’information est pollué” », 20 Minutes, Paris, 10 janvier 2018.
(7) Cf. Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, textes choisis et présentés par Razmig Keucheyan, La Fabrique, Paris, 2012.
(8) Cf. Cécile Manchette, « Onet. Victoire éclatante des grévistes du nettoyage des gares franciliennes », Révolution permanente, 15 décembre 2017.