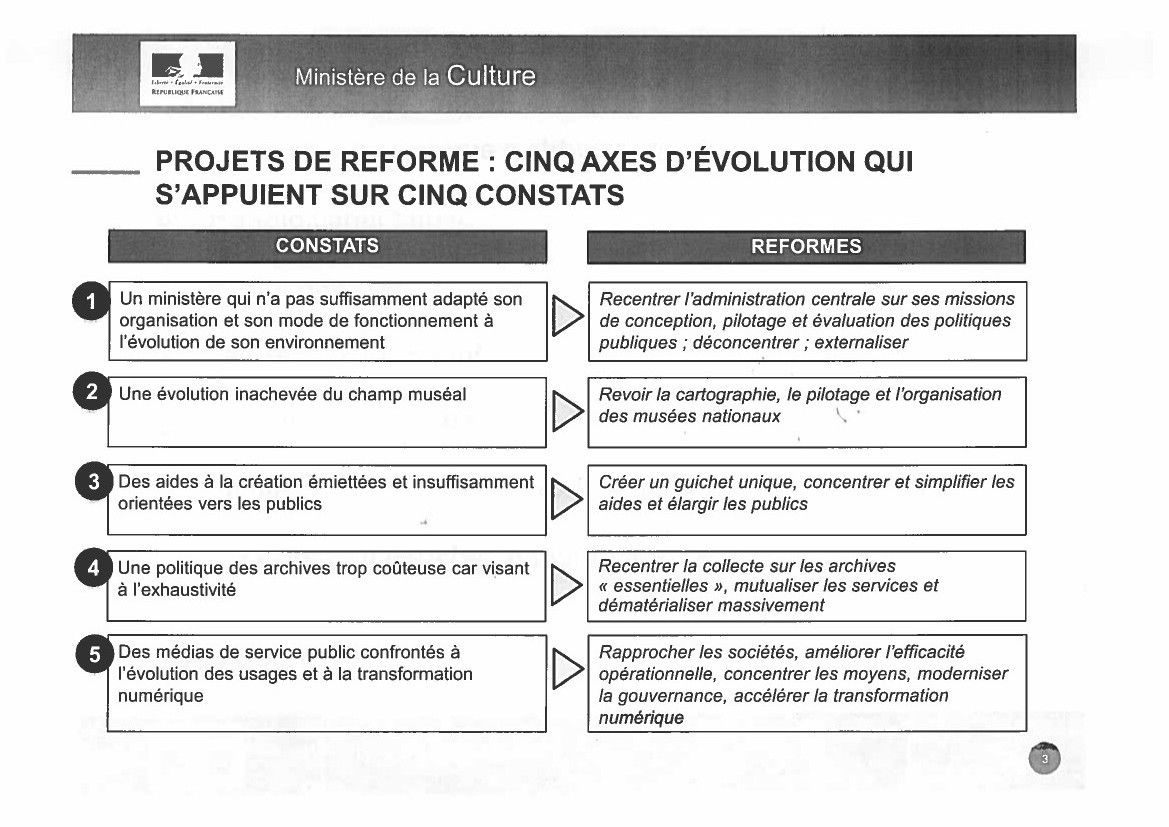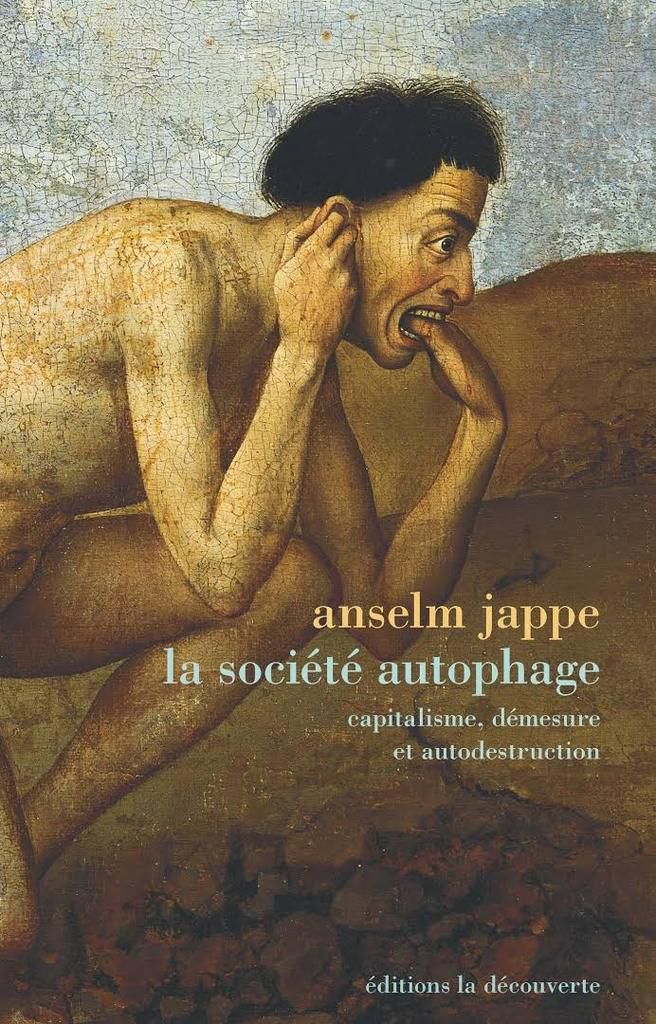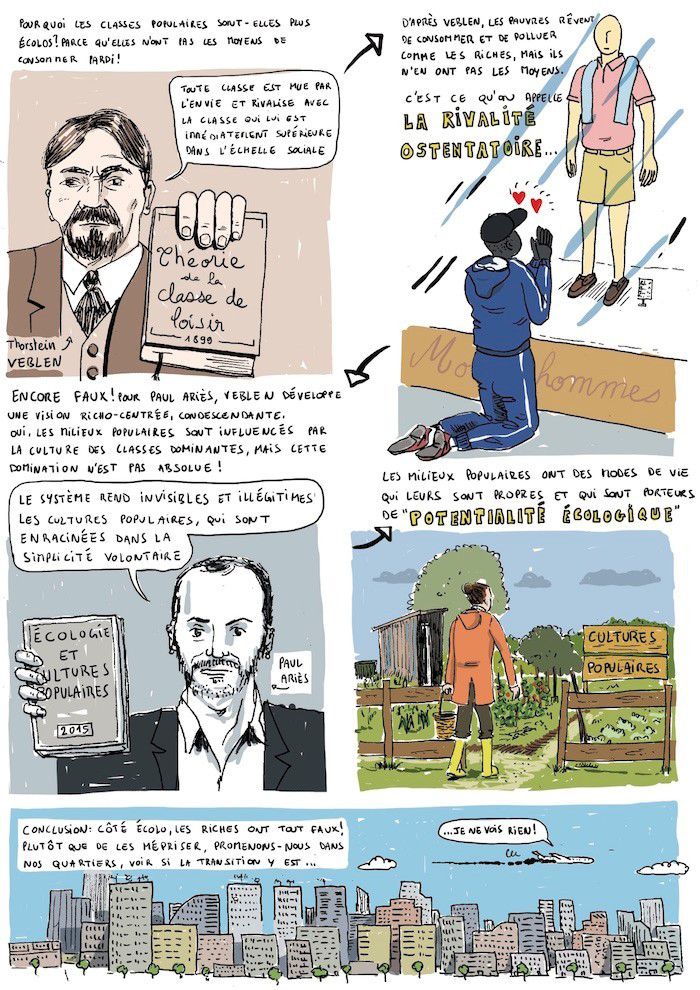Société Des études le prouvent : les hommes coupent la parole aux femmes trois fois plus souvent que l'inverse. Aux États-Unis, ce phénomène a un nom : le " manterrupting " Une leçon nécessaire pour les hommes comme pour les femmes pour changer ensemble ?
Par Anne Chemin le 3 mars 2017 pour Le Monde, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cf. aussi Un 8 mars revendicatif pour l'égalité salariale.
Sur le plateau, le tailleur rouge de Sylvia Pinel tranche avec les costumes gris de ses voisins. En ce jour de débat, la seule femme de la primaire de gauche évoque les leçons politiques de François Mitterrand quand David Pujadas lui pose une question sur le dépassement des clivages traditionnels. La candidate reprend la parole. " Ecoutez, c'est… ", commence-t-elle. Une voix s'élève à sa droite : sans lui jeter un regard, Jean-Luc Bennahmias répond à sa place. " C'est l'un des ratés du premier gouvernement Hollande de ne pas avoir permis à François Bayrou d'être élu ", explique-t-il avec assurance.
La caméra est tournée vers le visage de Jean-Luc Bennahmias mais on entend au loin un rire un peu crispé. " Jean-Luc, Jean-Luc, lance Sylvia Pinel en faisant un signe de la main. Je vois que la parité, même sur ce plateau, est difficile… C'est assez désagréable… " La candidate tente de reprendre le fil de ses idées mais elle a perdu pied. " Il est… C'est… Je ne me souviens même plus de la question ", ajoute-t-elle, un brin agacée. En ce 19 janvier, Sylvia Pinel vient de faire l'expérience d'un phénomène que toutes les femmes connaissent, même si elles en ignorent le nom : le manterrupting.
Le mot apparaît au début de l'année 2015, sous la plume de Jessica Bennett, une chroniqueuse pour le New York Times et le magazine Time. Dans un article intitulé " How not to be “manterrupted” in meetings " (" comment ne pas être interrompue par un homme en réunion "), elle raconte, études à l'appui, les étonnantes vicissitudes qui accompagnent la prise de parole des femmes. " Mes amies ont un terme pour ça : le manterrupting – contraction de man et interrupting – ", conclut Jessica Bennett. Depuis, le mot s'est peu à peu imposé dans les débats sur le sexisme ordinaire.
Malgré sa longue expérience politique – elle était la porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle de 2012 –, Nathalie Kosciusko-Morizet a fait l'amère expérience du manterrupting pendant la primaire de la droite et du centre. Lors du troisième débat télévisé, elle a été interrompue 27 fois… contre 9 pour Alain Juppé, 10 pour Jean-François Copé, 11 pour Jean-Frédéric Poisson, 11 pour Bruno Le Maire et 12 pour François Fillon et Nicolas Sarkozy. Commentaire de l'ancienne ministre : " Dans une assemblée mixte, les hommes ont tendance, parfois sans s'en rendre compte, à vouloir étouffer la parole des femmes et à la prendre. "
S'agit-il d'une pratique du monde politique liée au fait que les femmes en ont longtemps été exclues ? Une spécificité de cet univers clos qui, malgré l'instauration de la parité, peine tant à se féminiser ? Pas vraiment. Nombre d'études démontrent en effet que le manterrupting est une règle qui gouverne tous les échanges entre hommes et femmes, qu'ils aient lieu dans les bureaux, les cafés, les écoles ou les familles. Et ce n'est pas tout à fait un hasard. " La conversation, loin d'être une activité anodine et spontanée, est traversée par des questions de pouvoir ", écrit la féministe Corinne Monnet dans un article publié en 1998 dans la revue Nouvelles Questions féministes.
Si la théorie du manterrupting suscite souvent la perplexité, c'est parce que la sagesse populaire raconte une tout autre histoire. " Selon l'opinion communément admise, ce sont les femmes qui parleraient plus que les hommes, poursuit Corinne Monnet. Le stéréotype de la femme bavarde est certainement, en ce qui concerne la différence des sexes et la conversation, l'un des plus forts et des plus répandus. Paradoxalement, c'est aussi celui qui n'a jamais pu être confirmé par une seule étude. Bien au contraire, de nombreuses recherches ont montré qu'en réalité, ce sont les hommes qui parlent le plus. " Et qui interrompent le plus souvent leurs interlocuteurs – surtout si ce sont des femmes.
La première étude d'ampleur sur le man-terrupting a été réalisée en 1975 sur le campus de l'université de Santa Barbara (Californie). Cette année-là, deux sociologues, Don Zimmerman et Candace West, décryptent en –
détail 31 conversations enregistrées dans des cafés, des magasins et des lieux publics de l'université – des échanges ordinaires que les chercheurs appellent " everyday chit-chat ". Leurs conclusions sont stupéfiantes : dans les conversations non mixtes, les interruptions sont également réparties entre tous les participants, mais dès que la mixité s'installe, les chiffres s'emballent – les hommes sont responsables de 96 % des interruptions…
Don Zimmerman et Candace West voient dans ce déséquilibre un signe de la domination masculine. " Les hommes affirment de manière asymétrique un droit de contrôle sur les sujets de conversation et ils le font avec des conséquences évidentes, écrivent-ils. Il faut en conclure que, au moins dans ces transcriptions, les hommes contestent aux femmes le statut de partenaires égaux dans la conversation. " Bousculées par ces interruptions, les femmes peinent à maintenir le cap de leur discours. " Par toutes ces intrusions, les hommes parviennent à imposer leur propre sujet aux dépens de celui des femmes ", poursuit Corinne Monnet.
Les années 1970 sont loin, pensera-t-on : depuis cette époque, la révolution de l'égalité a bouleversé les règles du jeu. Ce n'est pas vraiment le cas. En 1998, deux professeurs de psychologie américains, Kristin J. Anderson et Campbell Leaper, analysent 43 études publiées de 1968 à 1998 consacrées aux " effets de genre sur les interruptions pendant les conversations ". Les déséquilibres mesurés à Santa Barbara sont loin d'avoir disparu. " On constate dans les recherches que les hommes ont, de manière significative, une tendance plus prononcée que les femmes à couper la parole de leurs interlocuteurs pendant une conversation ", résument-ils.
Une dissymétrie invisible
Pour en avoir le cœur net, deux chercheurs américains, Adrienne B. Hancock et Benjamin A. Rubin, analysent, en 2015, 80 conversations entre 40 participants – 20 femmes et 20 hommes. Pour éviter tout biais, ils choisissent des sujets " neutres ", comme l'utilisation du téléphone portable – pas de thèmes étiquetés féminins ou masculins. Les chiffres laissent rêveurs : dans un article publié dans le Journal of Language and Social Psychology, ils constatent qu'en moyenne, au cours d'une conversation de trois minutes, les femmes interrompent les hommes une seule fois alors que l'inverse se produit… 2,6 fois.
Ces règles du jeu ont beau gouverner la plupart des échanges entre hommes et femmes, elles passent le plus souvent inaperçues. " Lorsque le genre est à l'œuvre, comme dans la distribution de la parole, c'est le plus souvent de manière indirecte, donc invisible ", soulignent les politistes Frédérique Matonti et Delphine Dulong dans un article paru en 2007 dans Sociétés & Représentations (Publications de la Sorbonne). Pour mettre fin à cette myopie, les deux chercheuses ont, pendant plus d'un an, observé la répartition des rôles féminins et masculins au sein du conseil régional d'Ile-de-France.
Leur travail permet de prendre la mesure de l'ampleur de la dissymétrie entre hommes et femmes dans la prise de parole. Malgré l'instauration de la parité, le verbe continue à se décliner au masculin. " Le genre constitue un handicap, toutes choses égales par ailleurs, écrivent-elles. En séances plénières, quel que soit en effet le type d'intervention (dépôt d'amendement, rappel au règlement, questions orales, explications de vote), les hommes interviennent toujours plus que les femmes : sur huit séances entre avril 2004 et mars 2005, les hommes sont intervenus 142 fois et les femmes 80. "
Les hommes ne se contentent pas de parler plus que les femmes : ils écoutent aussi beaucoup moins. " Quel que soit leur capital politique et à rebours des stéréotypes genrés, les hommes bavardent beaucoup plus que les femmes avec leurs voisins lorsque les autres s'expriment, constatent les chercheuses. Certains, les plus aguerris, se lèvent même pour pouvoir parler avec un camarade assis plus loin alors qu'aucune femme ne s'autorise à le faire. Il faut ajouter que les hommes coupent beaucoup plus souvent la parole que les femmes et qu'ils la prennent davantage avant qu'on ne la leur ait donnée. "
La dissymétrie est aussi une question de style : le verbe impérieux des hommes tranche souvent avec la parole hésitante des élues. " Elles renoncent beaucoup plus facilement que les hommes à prendre la parole après l'avoir demandée au motif qu'un intervenant précédent aurait déjà dit ce qu'elles avaient à dire, écrivent Frédérique Matonti et Delphine Dulong. Leurs interventions sont beaucoup plus courtes que celles des hommes, et ce parce qu'elles posent plus de questions qu'elles n'expriment une opinion. (…) Elles “avouent” en outre beaucoup plus facilement qu'eux leurs doutes, leur absence d'opinion, voire leur incompétence. "
Nulle surprise, dans ce contexte, que la prise de parole soit, pour les femmes, une source d'angoisse. L'une des élues interrogées dans le cadre de cette étude raconte ainsi s'être réveillée, un jour de discours, " avec l'impression d'avoir avalé un parpaing ". " Cette expérience est partagée par toutes les élues, constatent Frédérique Matonti et Delphine Dulong. Claire Le Flécher, par exemple, s'oblige à prendre la parole, comparant l'exercice à un sport où l'entraînement est central. Anne Souyris parle longuement de sa difficulté à prendre la parole – une “transgression”, un “traumatisme”, un “supplice” qui revient, selon elle, à “se violer”. "
Sentiment d'illégitimité
Près de vingt ans après l'inscription du principe de parité dans la Constitution de la Ve République, les femmes ont encore du mal à imposer leur voix dans les enceintes politiques. Pour Frédérique Matonti, ce manque d'aisance renvoie à une longue histoire. " En France, les femmes sont encore des nouvelles venues en politique : le droit de vote leur a été accordé très tardivement, en 1944 – soit bien après les Finlandaises (1906), les Danoises (1915), les Américaines (1919) ou les Britanniques (1928). C'est d'ailleurs en France que l'écart entre la date du suffrage masculin (1848) et féminin (1944) est le plus important. "
Cette histoire a façonné des attitudes très différentes : selon Frédérique Matonti et Delphine Dulong, les hommes politiques se comportent comme s'ils jouissaient d'un " droit “naturel” à s'exprimer " alors que " tout, dans le comportement des femmes, manifeste leur sentiment d'illégitimité ". Quand les femmes sont dans des positions de pouvoir, confirme la philosophe et mathématicienne Laurence Bouquiaux dans Les Faiseuses d'histoire (La Découverte, 2011), un livre des philosophes belges Vinciane Despret et Isabelle Stengers, elles se conduisent comme si elles avaient " investi des lieux qui ne leur étaient pas destinés ".
Dans cet ouvrage, Laurence Bouquiaux raconte avec subtilité cette manière de se montrer " soumise et docile " pour faire oublier qu'on ne se sent pas tout à fait à sa place. Elle évoque ainsi, dans les milieux universitaires, " les bonnes élèves, bosseuses, voire besogneuses, qui savent qu'elles sont tolérées pour autant qu'elles restent inoffensives ". " Nous – les femmes – laissons parler les hommes (dans les réunions, dans les colloques et même, peut-être, dans les livres) parce que beaucoup de nos collègues ne nous pardonneront d'être intelligentes que si nous renonçons à être brillantes. "
Ces règles tacites ne concernent pas que la scène politique ou le milieu universitaire : nombre de travaux anglo-saxons montrent que, dans les entreprises, la prise de parole des femmes est mal accueillie. En témoigne une étude américaine réalisée par Victoria L. Brescoll, professeure à l'université Yale : cette experte en psychologie sociale a demandé à 156 personnes de noter, sur une échelle de 1 à 7, la compétence, l'efficacité, l'avenir professionnel et l'aptitude au leadership de deux types de manageurs – les premiers parlent beaucoup, se mettent en avant et font volontiers état de leurs opinions personnelles, les seconds sont discrets et s'expriment peu en réunion.
Publiés en 2012 dans la revue Administrative Science Quarterly, les résultats font froid dans le dos. Les hommes qui parlent peu sont considérés comme de piètres dirigeants alors que ceux qui s'expriment longuement obtiennent d'excellentes notes. Un diagnostic qui pourrait parfaitement se comprendre… s'il ne s'inversait totalement pour les femmes. La faconde et l'éloquence, considérées comme d'utiles qualités pour les hommes, deviennent de terribles défauts pour les femmes : les dirigeantes silencieuses et réservées en réunion sont bien notées alors que celles qui s'expriment longuement sont rejetées…
Peur d'avoir l'air agressive
Pour Sheryl Sandberg, numéro deux de Facebook, et le psychologue Adam Grant, professeur à l'université de Pennsylvanie, cette étude prouve que les femmes qui craignent de parler en réunion ne sont pas paranoïaques : elles savent simplement qu'en parlant autant, voire plus que les hommes, elles seront jugées avec sévérité. " Lorsqu'une femme s'exprime dans un cadre professionnel, elle marche sur une corde raide, résument-ils en 2015 dans le New York Times.Soit elle est à peine entendue, soit elle est jugée trop agressive. Quand un homme dit la même chose qu'elle, tout le monde approuve d'un signe de tête cette bonne idée. Résultat : les femmes considèrent souvent qu'il vaut mieux parler peu. "
Comment expliquer cette étrange alchimie sociale qui endigue la parole des femmes ? Pour la politiste Frédérique Matonti, la réponse tient en un mot : la socialisation. " Les études sur l'éducation montrent que les parents, sans en avoir conscience, encouragent les filles au retrait plutôt qu'à la mise en avant, explique-t-elle. Les garçons ont souvent le droit de faire du bruit alors que les filles doivent rester discrètes et baisser la voix. Petit à petit, les enfants intériorisent ces valeurs masculines et féminines : les garçons apprennent à prendre la parole, à dire qu'ils n'ont pas peur et à faire face, les filles à écouter et à faire attention aux autres. "
Ces différences se manifestent dans les familles, mais aussi à l'école. Dans les années 1970 et 1980, deux sociologues de l'éducation américains, Thomas L. Good et Jere E. Brophy, montrent, en observant le fonctionnement des classes, que les professeurs, sans le savoir, appliquent la " règle des deux tiers/un tiers " : ils ont, en moyenne, deux fois plus d'échanges avec les garçons qu'avec les filles. " Ils consacrent aux garçons les deux tiers de leur temps tandis que les garçons émettent les deux tiers des propos tenus par les élèves dans la classe ", résume la sociologue Marie Duru-Bellat dans L'École des filles. Quelle formation pour quels rôles sociaux ? (L'Harmattan, 2004).
Avec le temps, les chiffres ont évolué mais aujourd'hui encore, l'égalité de traitement n'est pas au rendez-vous. " Les enseignants consacrent un peu moins de temps aux filles – environ 44 % de leur temps contre 56 % aux garçons, souligne Marie Duru-Bellat. La différence peut paraître minime, mais elle devient considérable dès lors qu'on comptabilise le temps qu'un élève passe en classe. Ce temps consacré aux garçons reflète en outre des interactions plus formatrices sur le plan pédagogique : les enseignants passent plus de temps à réagir aux interventions des garçons et à attendre leurs réponses. "
Nul procès envers les hommes ici : les enseignantes, rappelle Marie Duru-Bellat, se comportent de la même manière que leurs collègues masculins. " Les hommes comme les femmes sont profondément imprégnés par des stéréotypes sur le féminin et le masculin qui sont véhiculés par notre société, constate-t-elle. Ce sont des processus inconscients qui définissent les normes de comportement des garçons et des filles – et donc les attentes et les comportements que l'on a envers eux. Pour les bousculer, il faut commencer par en prendre conscience. " En démontrant qu'hommes et femmes ne sont pas – encore – des partenaires égaux dans la conversation, les études sur le manterrupting ouvriront peut-être la voie à un dialogue plus équilibré entre hommes et femmes.
Anne Chemin