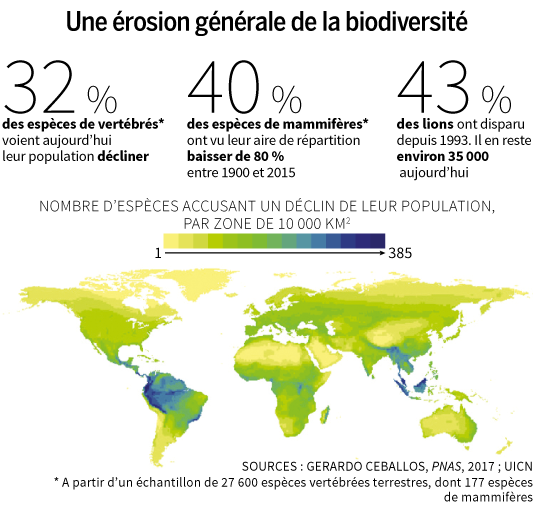Si l’existence d’un déficit démocratique de l’Union européenne ne fait plus de doute, on comprend trop rarement qu’il trouve sa source principale dans la transformation des traités européens en Constitution. C’est la conséquence de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les effets compromettent l’acceptation de l’intégration par les populations.
Jusqu’en 1963, il était admis que le droit européen relevait du droit international, et qu’à ce titre il n’obligeait que les États membres ; il ne pouvait avoir d’effets pour les individus d’un pays donné qu’après avoir été transposé dans son droit national. Tout au contraire, la CJUE de Luxembourg déclare cette année-là que les traités sont d’applicabilité directe (arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963). Cela veut dire que des droits subjectifs peuvent en dériver pour les individus. Ceux-ci ont la possibilité d’en réclamer le respect devant les tribunaux de leur pays sans attendre l’adaptation du droit national au droit européen.
Dans sa décision Costa vs Enel (15 juillet 1964), la CJUE va plus loin encore : elle déclare que les traités européens, et même chaque règle juridique européenne, jouissent de la primauté sur le droit national, y compris sur les normes suprêmes, à savoir les Constitutions. Les dispositions du droit national qui ne sont pas compatibles avec le droit communautaire perdent désormais automatiquement leur valeur. Aucune cour ni aucune autorité publique ne peut plus les appliquer. C’est cela qu’on a qualifié de « constitutionnalisation » des traités.
Ces deux arrêts sont le produit d’un revirement dans la méthode juridique. Selon la CJUE, le droit européen ne fait pas partie de l’ordre international. C’est un droit autonome, qui s’est émancipé de ses créateurs nationaux. Par conséquent, la Cour ne l’interprète plus comme il est de tradition en droit international, c’est-à-dire conformément à la volonté des parties contractantes et de manière restrictive lorsque la souveraineté nationale est touchée. La Cour interprète au contraire les traités comme une Constitution, c’est-à-dire plus ou moins indépendamment de la volonté de ceux qui les ont signés, par référence à un but objectivé et sans prêter attention à la souveraineté nationale.
Une Cour investie d’une mission
Conséquence immédiate de cette jurisprudence : l’intervention des États n’est plus nécessaire pour établir le Marché commun. La Commission (comme organe responsable de la mise en œuvre des traités) et la CJUE (comme organe responsable de l’interprétation des traités en cas de conflit) peuvent prendre en main l’intégration économique. Lorsqu’elles estiment que le droit national entrave le Marché commun, elles le déclarent inapproprié, sans que les gouvernements puissent réellement s’y opposer.
En effet, tout dépend désormais de l’interprétation que la CJUE donne des traités : favorable au marché ou à la gestion publique, favorable à l’uniformité des normes ou à la divergence, libérale ou sociale. Il devient très vite clair que la Cour poursuit, avec un zèle considérable, un but (l’intégration économique) en lui subordonnant tous les autres intérêts. Elle se sent investie d’une mission. Les compétences transférées à l’Union sont alors interprétées d’une manière extensive, les compétences retenues par les États membres d’une manière restrictive.
Les bénéficiaires de sa jurisprudence sont surtout les quatre libertés économiques (libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes) prévues par les traités. L’établissement du Marché commun devient une question jurisprudentielle plutôt que législative. Ainsi, les règles antiprotectionnistes sont interprétées comme hostiles à toute régulation ; l’interdiction d’accorder aux entreprises des subventions étatiques qui distordent la concurrence est pensée de façon tellement large qu’elle n’est pas seulement imposée au secteur privé, mais aussi aux services publics — sans considération du but poursuivi par le législateur et nonobstant le fait de savoir si le marché peut fournir des produits ou services de même qualité. Les exceptions sont interprétées restrictivement. Nombre des privatisations intervenues durant ces dernières décennies sont le fruit des arrêts de la CJUE. Soulignons avec force que tout cela ne résulte pas directement des traités, mais d’une interprétation qui n’était pas sans solution de rechange.
Cette jurisprudence a une influence profonde sur les lois et les politiques nationales. Par exemple, l’interprétation extensive de l’interdiction des barrières commerciales fait perdre aux États membres la possibilité de maintenir leurs exigences en matière de qualité des produits, d’emploi, de santé, etc. Celle de l’interdiction des aides aux services publics prive les gouvernements du droit de décider par eux-mêmes des domaines qu’ils laissent au marché et de ceux qu’ils veulent contrôler. Autre différence fondamentale : l’interprétation extensive de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (adoptée en décembre 2000) comme le renforcement des quatre libertés économiques conduisent à donner la préférence aux droits économiques, tandis que les Cours constitutionnelles nationales donnent la priorité aux droits des personnes.
La jurisprudence de la CJUE est souvent présentée comme une réussite pour la construction européenne. Pourtant, la médaille économique a un revers : la perte de légitimité démocratique de l’Union. Ce revers est devenu apparent quand les populations se sont aperçues que l’objet de l’intégration n’était plus seulement l’économie, mais aussi la politique, sans aucune chance pour elles d’influencer son développement.
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu’il existe dorénavant deux chemins vers l’intégration au lieu d’un seul. Le chemin original, fixé par les traités, consiste à produire du droit européen primaire (traités) et secondaire (directives, règlements adoptés par les institutions de l’Union). Le nouveau chemin consiste en l’interprétation et l’application des traités, telles que la CJUE les comprend ; il est ouvert aux pouvoirs exécutif et judiciaire de l’Union (Commission, CJUE). Ces deux chemins diffèrent considérablement. Sur le premier, les États membres transfèrent des compétences à l’Union. Ce chemin est politique et inclut les organes légitimés et contrôlés démocratiquement de chaque pays ainsi que le Parlement européen. Sur le second chemin, l’Union retire des compétences aux États membres par une interprétation extensive des traités. De nature administrative et judiciaire, ce chemin exclut les instances légitimées et contrôlées démocratiquement. Il s’agit d’une intégration secrète où les instances administratives et judiciaires jouissent d’une grande indépendance. Notons que le mode non politique du second chemin n’enlève pas aux décisions adoptées leur caractère politique. C’est plutôt la compétence de trancher les questions d’une grande portée qui se trouve transférée des organes politiques aux organes non politiques. Dans le même temps, les instruments destinés à garantir la légitimité et la responsabilité sont privés d’effet, notamment les Parlements et les gouvernements élus.
Cela ne veut pas dire que la CJUE poursuit une politique économique libérale. Elle poursuit avant tout l’objectif d’établir et de développer le Marché commun, but fixé par les traités. Mais, étant donné que la majorité des procédures devant la Cour émanent d’acteurs économiques qui prétendent que des lois nationales limitent leurs libertés, la Cour ne peut contribuer à établir le Marché commun que de façon « négative » (éliminer les réglementations nationales), favorisant ainsi le libéralisme.
Pourquoi cette évolution par la jurisprudence pose-t-elle un problème ? Les États membres, « maîtres des traités », n’ont-ils pas la possibilité de recadrer la CJUE en révisant les lois ? La réponse est « non », du fait de la constitutionnalisation des traités. Tout ce qui est réglé à l’échelon constitutionnel n’est plus ouvert aux décisions politiques. Cela ne pose pas de problème tant que les traités ne contiennent que des règles de nature constitutionnelle. Mais ce n’est pas le cas dans l’Union car les traités regorgent de normes qui seraient de droit ordinaire dans les États membres. C’est pourquoi ils sont beaucoup plus volumineux que la Constitution la plus détaillée d’un État.
Cette hyperconstitutionnalisation mine la position de « maîtres des traités » attribuée traditionnellement aux États membres. Un transfert imperceptible de pouvoir se produit. La frontière entre la révision et l’interprétation des traités s’efface. L’insuffisante distinction entre l’échelon constitutionnel et l’échelon de la loi, combinée avec la constitutionnalisation des traités, immunise la Commission et la CJUE contre toute tentative des organes démocratiques de corriger la jurisprudence par une révision des lois. Elle immunise aussi les organes exécutifs et judiciaires de l’Union contre la pression de l’opinion publique. Les acteurs politiques, qui doivent prendre en considération cette dernière, n’ont pas le pouvoir de changer les choses. Les acteurs non politiques, qui, eux, pourraient intervenir, sont en situation de pouvoir négliger l’opinion publique. La CJUE est plus libre que n’importe quelle cour nationale.
Certes, les États membres ne sont pas totalement démunis pour défendre leur position contre l’érosion imperceptible de leurs compétences. Lorsque celle-ci est le fait de la Commission, ils peuvent saisir la CJUE. Lorsqu’elle résulte de l’interprétation des traités, ils peuvent réviser ces derniers. Mais ces moyens sont d’une efficacité limitée. La CJUE se comprend plutôt comme moteur de l’intégration que comme arbitre neutre entre l’Union et les États membres. La révision des traités exige l’unanimité des États membres. Il semble donc presque impossible d’y recourir pour modifier la jurisprudence. Le résultat est un état de l’intégration européenne qui n’a jamais reçu le consentement des citoyens, et qu’ils ne peuvent pas changer même s’ils le rejettent.
La plupart des commentateurs cherchent la raison du déclin de l’acceptation de l’Union dans la faiblesse du Parlement européen. Mais il semble douteux que la transformation de l’Union en un système parlementaire puisse résoudre les problèmes démocratiques en Europe. Plusieurs raisons expliquent cela. L’une d’elles réside dans la faible représentativité du Parlement européen. Nous votons selon vingt-huit (bientôt vingt-sept) lois électorales différentes. Nous ne pouvons voter que pour des partis nationaux qui mènent campagne sur des programmes nationaux. Cependant, les formations politiques de chaque pays — elles sont plus de deux cents — ne jouent aucun rôle dans le Parlement de Strasbourg. Ce sont des regroupements politiques européens qui en sont les acteurs décisifs. Mais ils ne plongent pas leurs racines dans les sociétés et n’entrent pas en contact direct avec les électeurs. Cela réduit l’importance des élections européennes.
En outre, des Parlements peuvent remplir leur fonction médiatrice seulement s’ils sont insérés dans un processus vivant et permanent de communication avec la société qu’ils représentent. Il n’existe pas de débat public vraiment européen, mais vingt-huit discours nationaux sur les questions communes. Les forces intermédiaires qui doivent faire le lien entre les citoyens et les organes politiques entre les scrutins manquent ou sont peu développées. Dans la mesure où le substrat sociétal indispensable à une démocratie vivante fait défaut, la transformation de l’Union en un système parlementaire ne parviendrait pas à combler le fossé qui s’ouvre entre les citoyens et les institutions. En outre, il faut remarquer qu’on ne saurait accroître le rôle du Parlement européen sans diminuer celui du Conseil, qui réunit les gouvernements des États membres. Beaucoup de réformes proposées ont pourtant justement ce but. Le Conseil deviendrait alors une seconde chambre du Parlement. En contrepartie, la Commission serait élevée à un gouvernement parlementaire.
Cependant, l’élévation du Parlement sur l’échelle institutionnelle contribuerait peu à la démocratisation. On peut même dire que la transformation de l’Union en un système parlementaire affaiblirait au lieu de renforcer la démocratie en Europe. À l’origine, la légitimation démocratique de l’Union émanait seulement des États membres. Le Conseil était l’organe central de l’Union et son seul législateur. Ses décisions étaient prises à l’unanimité. Par conséquent, nul État membre ne se trouvait soumis à un droit que ses organes démocratiques n’avaient pas approuvé. Si les citoyens n’étaient pas satisfaits de la politique européenne de leur gouvernement, ils pouvaient exprimer leur mécontentement lors des élections nationales. Le principe de l’unanimité a été restreint en 1987. Dans la plupart des matières, le Conseil peut maintenant décider à la majorité. Ainsi, il est devenu possible qu’un État membre soit soumis à une loi qui n’a pas été approuvée par ses organes démocratiquement élus et contrôlés. Affaiblir encore le Conseil réduirait la légitimation externe de l’Union sans pour autant augmenter sa légitimation interne.
Reprendre la main sur la jurisprudence
Enfin, et surtout, la transformation de l’Union en un système parlementaire ne changerait rien aux conséquences de l’hyperconstitutionnalisation. Dans le domaine couvert par les traités constitutionnalisés, les élections n’ont pas d’importance. Le Parlement européen n’a aucune influence. La source du déficit démocratique ne peut donc être surmontée que par une repolitisation des décisions les plus importantes.
Si on veut augmenter la légitimité de l’Union, il faut transférer les décisions vraiment politiques des organes administratifs et judiciaires vers les organes politiques. La seule possibilité d’y parvenir consiste à limiter les traités aux dispositions ayant un caractère constitutionnel (c’est-à-dire celles définissant le cadre politique dans lequel seront prises les décisions sans préfigurer de leur contenu) et dont la responsabilité reviendrait aux États « maîtres des traités ». Dans le même temps, toutes les normes d’une nature non constitutionnelle doivent être dégradées à l’échelon du droit secondaire. Ainsi, les organes politiques de l’Union (Conseil et Parlement) pourront reprendre la main sur la jurisprudence lorsqu’ils estiment nécessaire de changer ce qui relève de la loi ordinaire. Juridiquement, c’est très facile. Politiquement, c’est difficile. En tout cas aussi longtemps que les coûts démocratiques de la constitutionnalisation échapperont à l’attention publique.
Dieter Grimm
Ancien membre de la Cour constitutionnelle fédérale allemande et professeur au Wissenschaftskolleg de Berlin. Ce texte est issu d’une conférence prononcée à l’invitation du Collège de France le 29 mars 2017.